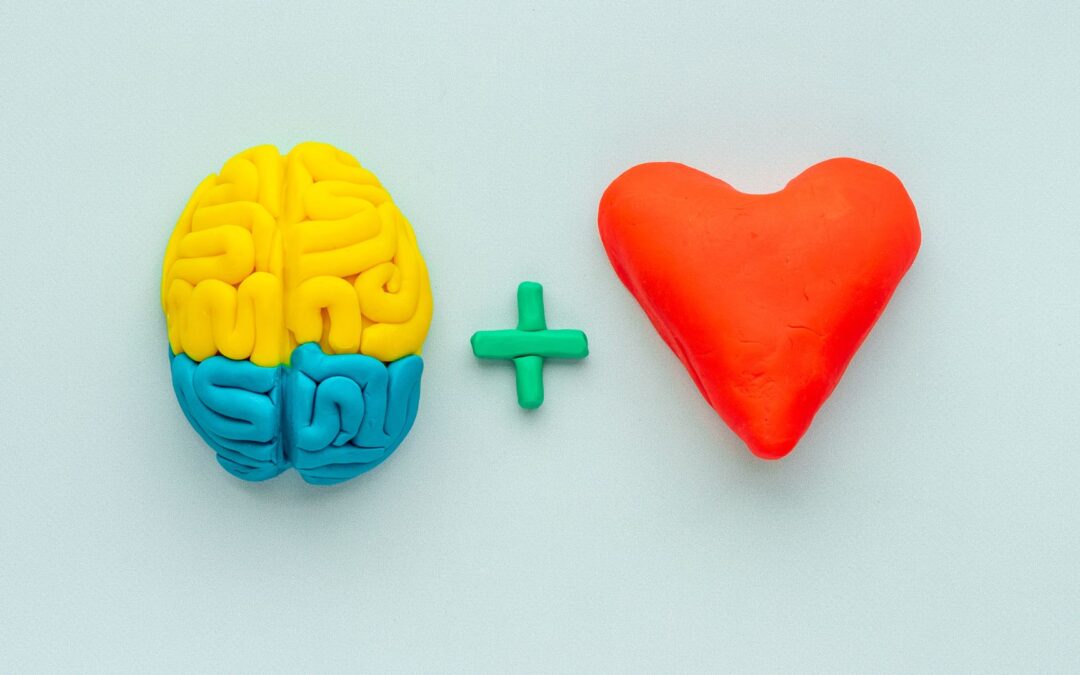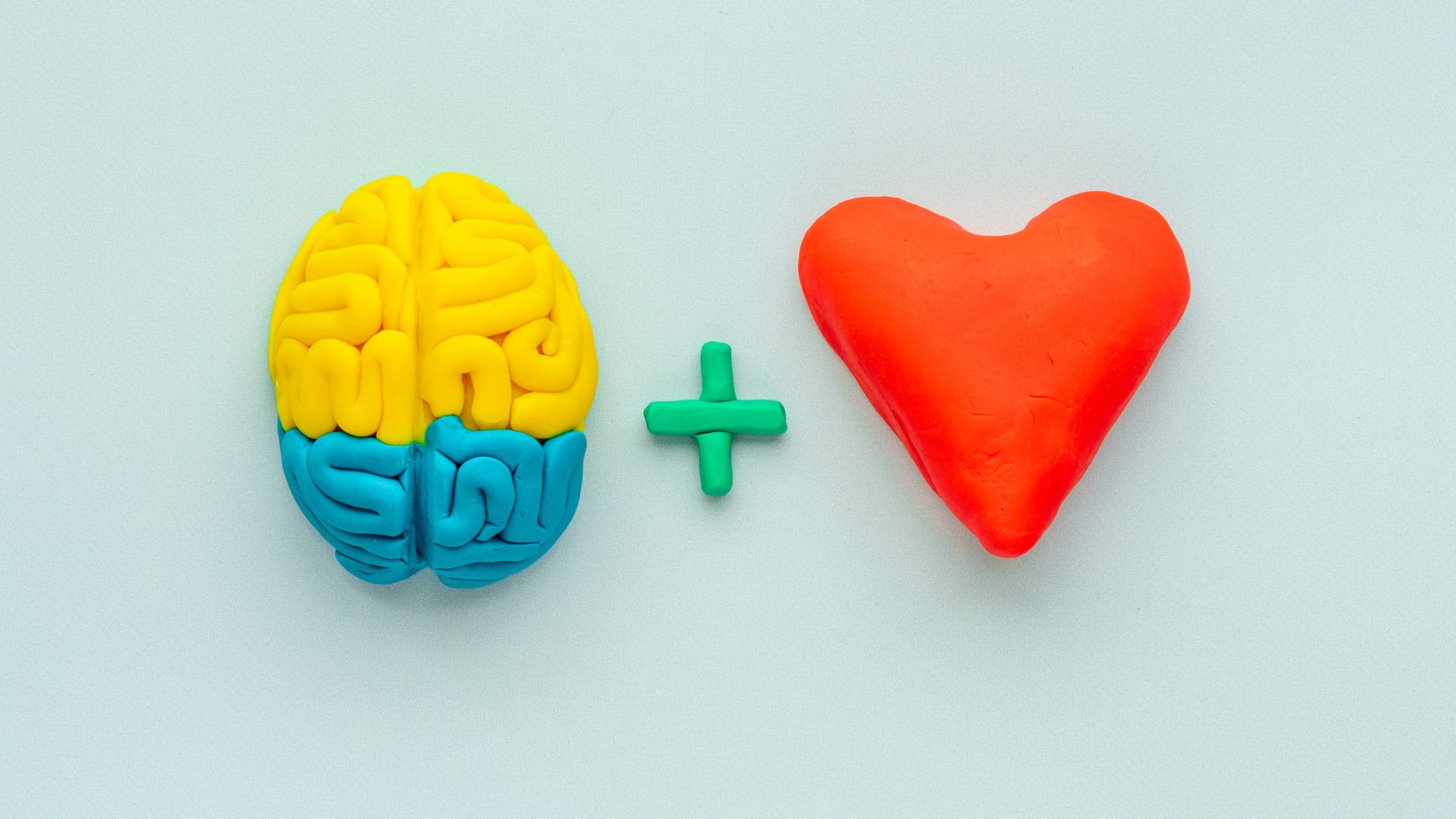Dans une TPE ou une PME, chaque investissement compte. La formation n’échappe pas à cette règle. Pourtant, beaucoup d’entreprises la perçoivent encore comme une obligation légale plutôt que comme un levier de performance. Identifier correctement les besoins de formation, c’est transformer un poste de dépense en moteur de développement. Pour y parvenir, il faut adopter une démarche structurée, qui relie les ambitions de l’entreprise aux compétences réelles de ses collaborateurs.
1. Comprendre le contexte et les objectifs de l’entreprise

Avant de penser au contenu des formations, il est essentiel d’analyser la situation de l’entreprise. Cela passe par une vision claire des objectifs à court, moyen et long terme.
Par exemple, une PME de l’immobilier qui veut élargir son marché vers la location saisonnière aura besoin de compétences différentes de celles d’une TPE spécialisée dans la maintenance informatique.
À cette étape, les managers et dirigeants doivent poser des questions précises :
- Où voulons-nous être dans un an, trois ans, cinq ans ?
- Quels marchés voulons-nous conquérir ou renforcer ?
- Quelles technologies ou réglementations vont impacter notre activité ?
Cette réflexion permet déjà d’esquisser les domaines de formation stratégiques. Dans le développement personnel, il peut s’agir de renforcer la communication interpersonnelle pour fluidifier les échanges internes. En digitalisation et technologie, l’enjeu pourrait être la maîtrise de nouveaux outils collaboratifs. En gestion d’entreprise et comptabilité, cela peut impliquer la mise à jour sur les dernières obligations fiscales.
2. Évaluer les compétences existantes
Une fois les objectifs clarifiés, il faut mesurer l’écart entre les compétences actuelles et celles nécessaires pour les atteindre. Cette étape se traduit par un audit des compétences.
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées :
- Entretiens individuels pour comprendre les besoins ressentis par chaque collaborateur.
- Autoévaluations via des questionnaires ou grilles de compétences.
- Observation en situation pour identifier les freins et zones d’amélioration.
Par exemple, dans le secteur marketing et vente, un commercial peut exceller dans la relation en face à face mais manquer d’aisance sur la prospection digitale. En ressources humaines, un responsable peut maîtriser le droit du travail mais avoir besoin de renforcer ses compétences en recrutement digital. Dans le domaine santé et sécurité au travail, un chef d’équipe peut ignorer les nouvelles normes liées à son secteur.
Cette analyse fine évite de financer des formations inadaptées. Elle permet aussi de personnaliser les parcours, ce qui favorise l’engagement et la motivation des salariés.
3. Identifier les priorités
Toutes les compétences à développer ne peuvent pas l’être simultanément. Il est donc crucial d’établir des priorités.
Pour y parvenir, plusieurs critères peuvent guider le choix :
- Impact direct sur la performance ou la productivité.
- Urgence liée à une évolution réglementaire ou technologique.
- Coût et durée de la formation par rapport au retour attendu.
Prenons l’exemple d’une TPE de gestion immobilière : la formation à un nouveau logiciel de gestion locative peut être plus urgente que le perfectionnement en techniques de négociation, si le logiciel doit être déployé dans deux mois. De même, une PME industrielle devra prioriser la formation en sécurité si de nouvelles machines plus complexes arrivent en production.
Le principe est simple : former d’abord là où le risque ou l’opportunité est le plus élevé. Cette hiérarchisation permet d’allouer efficacement les budgets formation, souvent limités dans les petites structures.
4. Relier besoins individuels et projet collectif

Une erreur fréquente consiste à concevoir la formation uniquement comme une réponse à un besoin individuel. Bien sûr, un salarié motivé à progresser sur un sujet spécifique doit être encouragé. Mais dans une TPE/PME, la formation doit aussi renforcer la cohésion et servir la stratégie globale.
Cela implique de créer des passerelles entre les aspirations personnelles et les objectifs collectifs. Par exemple :
- Un collaborateur en développement personnel qui souhaite améliorer sa gestion du stress pourra bénéficier d’un programme intégrant aussi la gestion des priorités, utile à l’ensemble de l’équipe.
- Un cadre en leadership et management peut suivre une formation sur la conduite du changement, qui profitera à la fois à son développement et à la transformation de l’entreprise.
- Un comptable en gestion d’entreprise pourra se former aux outils de business intelligence, contribuant ainsi à la prise de décision stratégique.
Ce double alignement renforce l’engagement et garantit un retour sur investissement.
5. Anticiper les évolutions du marché et de la réglementation
Les besoins de formation ne se limitent pas aux lacunes actuelles. Les entreprises qui réussissent anticipent les évolutions futures pour former avant que le besoin ne devienne urgent.
Cela suppose une veille active :
- Technologique : intelligence artificielle, cybersécurité, automatisation…
- Réglementaire : normes environnementales, obligations fiscales, droit du travail.
- Sectorielle : nouvelles tendances de consommation, mutations des modes de vente.
Dans le domaine digitalisation et technologie, former en amont sur un outil CRM ou un logiciel de gestion documentaire peut donner un avantage compétitif. En santé et sécurité au travail, anticiper les nouvelles normes ISO permet d’éviter les non-conformités coûteuses. En marketing et vente, maîtriser tôt une nouvelle plateforme publicitaire peut ouvrir des opportunités avant la concurrence.
L’anticipation évite de subir les changements et transforme la formation en atout stratégique.
6. Construire un plan de formation agile
Une fois les priorités fixées, il est temps de bâtir un plan de formation. Celui-ci doit être structuré, mais aussi suffisamment flexible pour s’adapter aux imprévus.
Les TPE/PME peuvent combiner différents formats :
- Formations courtes pour des mises à jour réglementaires.
- Modules en e-learning pour une montée en compétence progressive.
- Ateliers pratiques pour développer des savoir-faire opérationnels.
- Coaching individuel pour accompagner les managers ou profils clés.
Un bon plan prévoit aussi le suivi post-formation : évaluation des acquis, mise en pratique, ajustements éventuels. Cela garantit que les compétences ne restent pas théoriques mais se traduisent par des résultats tangibles.
Dans le leadership et management, un coaching après formation peut consolider les nouveaux réflexes managériaux. En gestion d’entreprise et comptabilité, des sessions de suivi permettent de vérifier l’intégration des nouvelles méthodes.
7. Mesurer l’impact et ajuster
La dernière étape, souvent négligée, consiste à évaluer l’efficacité des formations.
Plusieurs indicateurs peuvent être suivis :
- Amélioration de la productivité.
- Réduction des erreurs ou incidents.
- Satisfaction des clients.
- Engagement des salariés.
En ressources humaines, par exemple, une formation sur le recrutement digital peut se mesurer par la réduction des délais de recrutement et l’amélioration de la qualité des candidats. En marketing et vente, l’impact peut se voir dans l’augmentation des leads ou du chiffre d’affaires.
Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, il faut analyser les causes : contenu inadapté, manque de suivi, mauvais timing… L’important est de faire de la formation un processus continu d’amélioration, et non un événement ponctuel.
Conclusion
Identifier les besoins de formation dans une TPE ou une PME ne relève pas du hasard. C’est une démarche méthodique, qui commence par comprendre les objectifs stratégiques, se poursuit par l’analyse fine des compétences et se concrétise par un plan de formation agile, aligné sur les priorités.
En intégrant les domaines clés comme le développement personnel, la digitalisation, la gestion d’entreprise, l’immobilier, le leadership, le marketing, les RH et la santé-sécurité, chaque investissement formation devient un moteur de performance durable.
Découvrez tous nos autres articles de blog en cliquant ici.